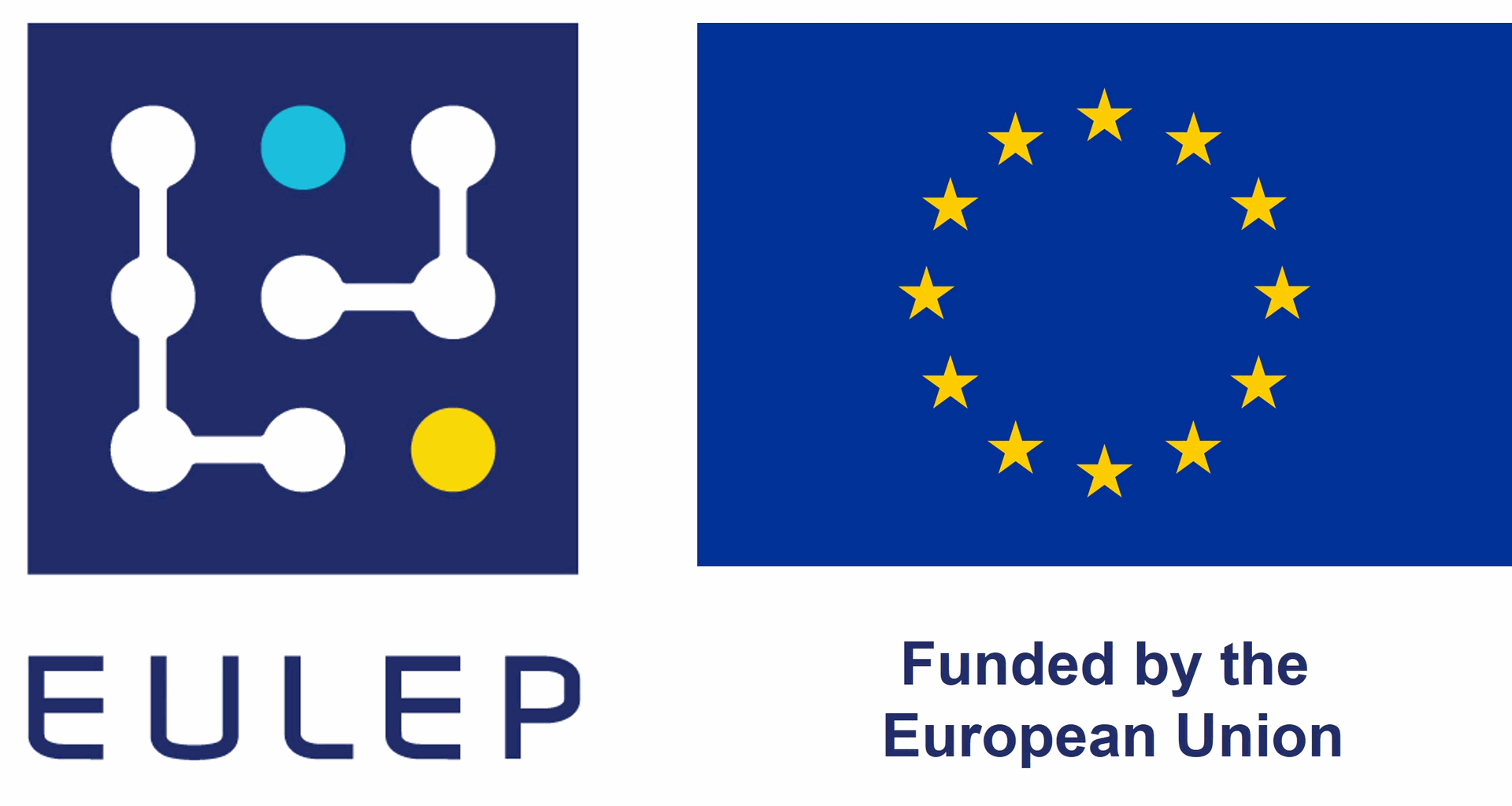Suivre sa passion ou faire un choix d’étude dit « raisonnable » ? Ce dilemme a de tout temps animé des jeunes en quête d’un avenir épanouissant. Mais les interrogations professionnelles d’aujourd’hui ne se limitent pas à ce seul arbitrage.
Il est parfois des étudiant·es brillant·es dont l’avenir paraît tout tracé, puis rattrapé·es par leur passion. Il en va ainsi d’Alex Wieczoreck. Muni d’un diplôme de journalisme et d’ingénieur commercial de Solvay, celui qui aurait pu tout aussi bien devenir consultant, banquier privé ou CFO optera finalement pour le stand-up puis la carrière d’humoriste et chroniqueur que l’on sait. La chanteuse Axelle Red, elle, décrocha un diplôme en droit de la VUB avant de connaître la célébrité.
Giles Daoust, par ailleurs contributeur aux pages de ce journal, aura été producteur de cinéma avant de diriger l’entreprise familiale… A l’inverse, SangHoon Degeimbre se rêvait pharmacien lorsqu’il était adolescent, avant de se tourner un peu par hasard vers l’école hôtelière et de devenir le chef iconique et doublement étoilé de « l’air du temps ».
Peur du mauvais choix
Comment conjuguer raison professionnelle et passion ? Derrière les dilemmes et questionnement qui ont traversé ces personnalités en figurent des milliers d’autres, comme en atteste le succès non démenti des salons et ateliers d’orientation. « Nous n’arrivons pas à répondre à toutes les demandes. Souvent, les jeunes disent avoir peur de faire un mauvais choix et de ne plus pouvoir bifurquer par la suite », explique Joséphine Mondry, conseillère et chargée de projets au SIEP, le Service d'Information sur les Etudes et les Professions.
Ces jeunes, qui sont souvent accompagné·es par leurs parents, craignent ainsi de perdre du temps ou de s’engager sur une voie qui conditionnera toute leur vie et dont ils ou elles ne pourront plus s’extraire ensuite. Face à ces incertitudes, beaucoup optent pour des cursus universitaires – par exemple des baccalauréats de transition – susceptibles de maintenir un maximum de « portes ouvertes » le plus longtemps possible. « Mais le risque, c’est de perdre le sens ou l’envie après quelques mois et de décrocher dès la première année du supérieur », pointe Joséphine Mondry.
Satisfaits, frustrés, fatalistes ou rebelles
Pour autant, les arbitrages auxquels ces jeunes se livrent ne se limitent plus à des questions de débouchés et d’aspirations profondes. « Les jeunes ont parfois du mal à se projeter dans des environnements professionnels. Même s’ils ont une idée des perspectives que leur offre un diplôme, ils ne peuvent pas réellement appréhender ce que sera leur réalité professionnelle au quotidien », poursuit Joséphine Mondry.
Un constat que corrobore une récente étude publiée par l’Institut Montaigne, le think tank parisien. On y découvre une jeunesse qui, loin d’être démissionnaire, reste attachée à la valeur « travail » mais pour qui les premières années professionnelles sont aussi souvent synonymes de désillusion.
A côté du groupe des « satisfait·es », dont le rapport au travail est positif et apaisé, la recherche identifie ainsi trois autres typologies de jeunes - à ranger dans le camp des déçus -et qui, prises dans leur ensemble, semblent constituer aujourd’hui la majorité de la génération Z.

« Souvent, les jeunes disent avoir peur de faire un mauvais choix et de ne plus pouvoir bifurquer par la suite » - Joséphine Mondry, conseillère et chargée de projets au SIEP, le Service d'Information sur les Etudes et les Professions
A commencer par cette catégorie de la jeunesse que l’étude décrit comme « frustrée » (28% de l’échantillon). Le résultat d’un décalage prégnant entre ses attentes et la réalité des emplois, générant dès lors des sentiments de contestation ou de démotivation. Autre groupe important, celui des fatalistes (20%) qui, face à cette réalité, ont rabaissé leurs attentes vis-àvis du travail à un niveau très bas. Enfin les rebelles (20%), satisfait·es de leur emploi mais développant une réticence à l’autorité et, pour finir, un rejet de l’entreprise.
Faire du qualifiant un choix positif
Cette désillusion, note encore l’étude, touche davantage les plus diplômé·es et les formations universitaires généralistes (lettres, sciences humaines et sociales) que les jeunes issu·es de formations professionnelles. On perçoit là comme une étrange contradiction. Le blues professionnel toucherait donc avant tout les jeunes « cols blancs » alors même que ce sont les filières techniques et manuelles qui demeurent les moins valorisées auprès des étudiant·es.
« L’idée de filières professionnelles et qualifiantes comme étant « de relégation » demeure très ancrée dans les écoles secondaires. Parce qu’il fait souvent suite à des embûches, un tel choix est vécu comme d’autant plus contraint et limitant qu’il est opéré tôt dans un parcours. Par ailleurs, ce qu’on sait trop peu, c’est que ces filières permettent elles aussi de décrocher le Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur et d'accéder à l'enseignement supérieur si on le souhaite », analyse Joséphine Mondry. D’où la nécessité impérieuse de transformer ces parcours en choix positifs
Autonomie et salaire
Plus largement, plutôt que sur la nature même de leur job, les attentes des plus jeunes semblent se porter de plus en plus sur la qualité de vie au travail, en ce compris le rapport avec les collègues. Une récente étude menée par le Forum des jeunes de la Fédération Wallonie-Bruxelles a ainsi établi que pour la grande majorité (71%), la bonne ambiance dans l’équipe est le premier critère de bien-être professionnel. Signal alarmant : 28% disent avoir été victime d’harcèlement.
Plus largement, l’Institut Montaigne souligne que l’équilibre temps libre-temps de travail et l’absence de stress pèsent lourd dans leurs choix. « Cette question revient très souvent, bien plus encore qu’il y a 6 ou 7 ans », confirme Joséphine Mondry. Enfin, la rémunération demeure cardinale, révèlent les deux études. « Je reste assez interloquée par l’importance accordée aux salaires et côtés praticopratiques, avant même d’identifier ses passions et intérêts », souligne Joséphine Mondry. Loin des idéaux professionnels, la génération Z serait-elle devenue celle de l’hyper-pragmatisme ?